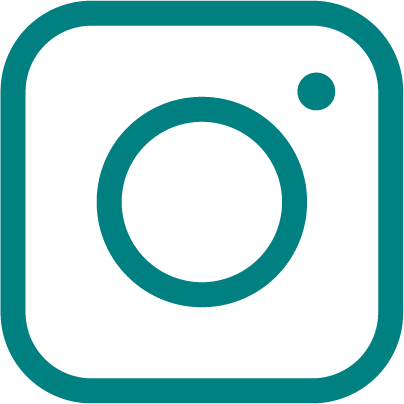Zoé Kergomard
Dans ce billet de début d’année, je voudrais revenir sur les discussions que nous avons eu ces derniers mois au Réseau suisse des historiennes autour des outils numériques. Nous avons notamment eu le grand plaisir d’en discuter en juin 2022 avec deux expertes des humanités numériques : Christine Gründig (Digital History Lab, Université de Zurich) et Mareike König (Département Histoire numérique, Institut historique allemand, Paris) lors de notre table-ronde virtuelle : «Wie digitale Arbeitsweisen unseren Berufsalltag als Historikerinnen verändern (oder auch nicht)».
A l’origine de cette réflexion, il y a simplement les coulisses numériques d’une jeune association suisse au début des années 2020 : réunions en ligne, emails en pagaille, dossiers partagés, sondages en ligne pour se mettre d’accord sur les dates, tout ça souvent en plusieurs langues… Toutes nos activités, qu’il s’agisse de projets collectifs, de l’enseignement ou de la recherche individuelle, impliquent des outils numériques divers et variés. Comme tout le monde, au quotidien, nous n’y pensons pas plus que ça. Nos habitudes de travail numériques sont plus ou moins anciennes et routinisées – a fortiori depuis les premiers moments de télétravail sous Covid. Nous ne parlons de ces outils que quand ils ne marchent pas bien ou plus du tout, ou quand ils impliquent des coûts, par exemple quand il faut renouveler une licence.
Quels outils, quels choix et quel travail derrière nos usages numériques ?
Pourtant, comme toutes historiennes qui se respectent, nous sommes sensibles à l’historicité des outils et partant, aux choix techniques, économiques mais aussi politiques qui ont orienté leur conception puis leur utilisation. Mais nous manquons souvent de savoir-faire, et je dois donc dire que nous nous sommes donc parfois retrouvées à demander de l’aide à des hommes de nos cercles proches, notamment pour concevoir ce site web. Je tiens à préciser que c’est par contre notre formidable ancienne membre du comité Melanie Burckhardt qui a développé notre logo et notre ligne graphique.
Pour le reste, une petite confession : j’ai un ingénieur pédagogique « à la maison » (ci-après « S. »), activiste pour les libertés numériques par ailleurs (droit à la vie privée, lutte contre la surveillance numérique et contre les entreprises monopolistiques du secteur…). Je dépends de lui pour l’infrastructure numérique de ma recherche – coucou les photos d’archives et les 13000 entrées (et quelques) de ma bibliothèque Zotero, synchronisées sur le serveur trônant au milieu de notre salon par le biais du logiciel (libre) Nextcloud.
Je lui ai aussi posé plein de questions sur les meilleurs outils pour le Réseau, par exemple pour sauvegarder et synchroniser nos données qui sont parfois confidentielles (les coordonnées des membres par exemple). Les solutions commerciales et gratuites, type Googledrive ou Dropbox, impliquent de perdre la souveraineté sur les données (« there is no such thing as a free lunch»). Il y a bien en Suisse, par le biais de la fondation supra-universitaire Switch, l’option des dossiers partagés Switchdrive, qui fonctionnent avec Owncloud (autre logiciel libre) et garantissent la sécurité des données, mais seules les universitaires parmi nous y ont accès. Notre ambition de réunir des historiennes* de tous horizons se heurte ainsi parfois à de telles frontières technico-institutionnelles.
Au total, le cloud de notre salon s’est donc trouvé être la solution la plus simple, la plus sûre et aussi la moins chère pour gérer les données de notre association – parce que S. s’en occupe bénévolement. J’en rigole souvent en disant que c’est sa contribution « à la cause » en tant qu’homme allié pro-féministe. Plus prosaïquement, ça nous a évité bien des drames du 21è siècle (perdre soudainement des données et donc parfois des années de travail). Mais on est constamment confrontés à ma dépendance un peu trop confortable, et donc dangereuse, à son expertise et à son travail.
Cette division intime des tâches et des compétences renvoie douloureusement à la sous-représentation plus générale des femmes* dans les métiers de l’informatique. Elles étaient pourtant majoritaires à l’origine, lorsque ces métiers étaient encore peu valorisés, comme l’a notamment montré Mar Hicks dans son livre Programmed Inequality : How Britain Discarded Women Technologists and Lost Its Edge in Computing. Depuis, les modes de socialisation scolaire, entre exclusion et auto-censure, ont eu tendance à détourner les femmes des matières scientifiques.
Dépasser les barrières entre technophiles et « néo-luddites »
Les historien*nes d’aujourd’hui qui veulent se former aux outils numériques ne sont pas non plus aidé(e)s par leur complexité croissante, leur renouvellement constant, mais aussi par le manque de temps résultant de la surcharge de travail et des statuts précaires dans les métiers de l’histoire, et par les barrières institutionnelles parfois trop rigides – c’est le paradoxe de l’institutionnalisation des humanités numériques.
Avec Christine Gründig et Mareike König, nous avons donc voulu aussi réfléchir aux interactions entre manières de travailler « analogues » et « numériques ». Nous voulions éviter de tomber dans un débat stérile entre technophiles non-critiques et « néo-luddites » réfractaires (l’excellente série norvégienne Beforeigners imagine un mouvement « néo-luddite » au 21è siècle, un régal). En fait, nous jonglons toutes entre différents logiciels et prises de notes à la main, ne serait-ce que pour se reposer et éviter le sur-plein de sollicitations liées au numérique. Hors de l’étiquette des humanités numériques, nous faisons toutes de « l’histoire soutenue par le numérique » (ma mauvaise traduction de « digital gestützte Geschichte ») dès lors que nous allumons notre ordinateur.
Alors, sans toutes devenir des informaticiennes ou mêmes des « historiennes numériques », comment pouvons-nous reprendre le pouvoir sur les outils numériques que nous utilisons au quotidien ?
Les outils numériques sont des choix politiques… et pragmatiques
Comme souvent, ça peut déjà passer par choisir ces outils en connaissance de cause, en s’informant déjà sur leur provenance et leur fonctionnement. Pas besoin de savoir coder pour se renseigner sur les enjeux politiques et commerciaux des logiciels et sur la sécurité des données. Sur cette base, notre comité a par exemple décidé de ne pas renouveler notre licence Zoom, un logiciel propriétaire en voie de devenir monopolistique et dont la politique des données n’offre pas de bonnes garanties – elle n’est a priori même pas compatible avec la RGPD (voir par exemple ces explications de l’association allemande Cyber4edu, qui propose aussi une liste de solutions alternatives, notamment à Doodle &co). Pour nos réunions et évènements en ligne, nous allons utiliser deux logiciels libres hébergés par des associations, auxquelles nous feront un don de l’équivalent de la licence Zoom : le formulaire en ligne Framaforms géré par l’association Framasoft pour l’inscription, et le système de visioconférence et d’apprentissage en ligne Bigbluebutton mis à disposition par l’association Cyber4edu également.
Pour moi, c’est déjà un peu reprendre le pouvoir au petit niveau de notre association que de choisir et de soutenir financièrement des alternatives plus éthiques pour les libertés numériques. Comme beaucoup de monde ces derniers mois, ça veut aussi dire que j’ai pas mal tergiversé sur les dilemmes de réseaux sociaux du moment: quitter Twitter, où j’ai construit un petit réseau bienveillant depuis cinq ans, et/ou tenter la grande aventure Mastodon, qui pour le coup est un modèle d’Internet décentralisé.
Mais malgré tous les bons conseils de Mareike à ce sujet, je dois dire que ma flemme et/ou mon pragmatisme ont pris le dessus: j’en ai profité pour faire une pause des réseaux sociaux, et je recommande – ça fait du bien. J’ai accepté que je n’ai pas l’énergie mentale pour m’adapter rapidement à de nouveaux outils et de nouvelles manières de faire, donc j’attends de voir. Mon temps de retard à l’allumage est aussi la raison pour laquelle ce billet est certifié 100% sans ChatGPT ou avis tranché sur ChatGPT – je n’ai même pas encore essayé.
Parce qu’on peut aussi simplement se demander si on a vraiment besoin d’un nouvel outil qu’il-est-beau-qu’il-brille. Comme beaucoup, je crois que j’ai commencé à m’intéresser aux humanités numériques en début de thèse en me formant à Zotero, parce que ça m’a amenée à m’interroger sur mes pratiques de veille informationnelle mais aussi de mise en relation de mes références bibliographiques et de mes sources les unes avec les autres (vive les étiquettes et les renvois d’une entrée à l’autre). Je suis donc ravie d’avoir investi du temps pour m’approprier Zotero à l’époque, parce que ça a nettement enrichi mes pratiques de recherche en plus de me faciliter la vie. Mais par la suite, je suis parfois tombée dans une forme de procrastination moderne : la recherche sans fin du meilleur logiciel, par exemple du meilleur gestionnaire de notes – alors que le plus important, c’est de pouvoir conserver et retrouver ses notes à long terme, même si c’est sur papier ou dans un format très basique.
Surtout, les seuils d’entrée pour se former et se lancer peuvent être élevés et il est donc toujours légitime de se demander si le jeu en veut vraiment la chandelle. Se former au très performant logiciel de transcription Transcribus par exemple ne vaut pas forcément la peine pour de petits corpus, mais peut être très pertinent au début d’un projet impliquant un gros corpus. D’où l’intérêt de projets collaboratifs, comme la plateforme de transcription collaborative www.transcriptiones.ch dont la pionnière Yvonne Fuchs va bientôt nous raconter la naissance sur ce blog.
Comment développer la réflexivité sur nos pratiques de recherche numérico-assistées ?
Une autre manière de (re-)prendre le pouvoir, c’est comme souvent de réfléchir à ce que les outils font à nos pratiques de recherche. Entre temps, les différents modules sur la digital literacy proposés pour les étudiant*es (en Suisse, Compas proposé par Infoclio.ch, ou encore le luxembourgeois Ranke.2) mettent bien en lumière les différents biais des algorythmes de recherche en ligne, ou encore les limites de l’OCRisation des sources numérisées. Comme au bon vieux temps des catalogues d’archives sur fiches, il est utile de combiner différents types de recherche dans différentes bases de données, analogues et numérisées, avec des critères de recherche différents etc. Mareike et Christine recommandent en ce sens d’utiliser un « journal de recherches » documentant les différentes recherches et leurs limites, pour éviter de se retrouver piégé*e en tombant toujours sur les mêmes résultats.
Contrairement à l’impression courante de collègues obsédés du « big data », les humanités numériques réfléchissent d’ailleurs beaucoup aux limites des « archives numériques » en prolongeant d’ailleurs la pratique de la critique des sources « analogues » (voir le « goût de l’archive » revisité par Frédéric Clavert et Caroline Muller à l’ère numérique, ou encoe ce récent volume sur les journaux numérisés dirigé par Frédéric Clavert également, Estelle Bunout et Maud Ehrmann). Pour le futur, l’un des enjeux est bien d’élargir les possibilités de discuter de ces questions et d’ouvrir la « boîte noire » de nos pratiques numériques.
Les formats classiques de publication ne permettent pas encore assez, surtout quand on est début de carrière, de développer une réflexivité sur ses pratiques de recherche – et ce problème dépasse sans doute les seules pratiques numériques. A part les chapitres méthodologiques souvent indigestes en début de thèse, les conventions narratologiques habituelles en histoire rendent souvent difficile d’interrompre le récit pour discuter comment on est arrivé à telle ou telle source, par exemple.1 Les blogs scientifiques sont en conséquence toujours et encore des espaces essentiels de discussion sur ces questions – en souhaitant qu’elles essaiment au-delà.
1Comme l’expliquent notamment Fred Gibbs et Trevor Owens, The Hermeneutics of Data and Historical Writing, in: Nawrotzki, Kristen; Dougherty, Jack (dir.): Writing History in the Digital Age, Ann Arbor 2013, pp. 159–170.